C’est sans espoir. Les Femmes du bus 678, premier long-métrage de Mohamed Diab, met en scène le combat de trois femmes d’aujourd’hui contre le harcèlement sexuel dans les rues cairotes. Ça se passe en Egypte, ça pourrait être au Maroc…
Dès les premières images du film Les femmes du bus 678, je me mets à pleurer. Une jeune bourgeoise, lisse et inoffensive, se fait brutaliser par des hooligans à la sortie d’un match de foot au Caire. Son mari, témoin, traumatisé, ne veut plus la toucher après ça, n’ose même pas la regarder. Elle est paria, elle est salie et lui aussi, impuissant qu’il a été à la sauver de tous ces hommes qui ont mis la main sur elle.
Mes larmes coulent, silencieuses dans cette salle de cinéma parisienne à moitié remplie de la rue Mouffetard une après-midi d’août. Je sais pourquoi je pleure. La boule dans mon ventre, cette boule qui remonte et me fait serrer les lèvres, je la connais bien. Elle est familière, elle est infinie, elle a quelque chose de tragiquement triste qui remonte à loin, avant ma naissance, avant ma propre expérience de ne pas pouvoir marcher dans les rues de mon pays, avant le pouvoir, la violence et la lâcheté des hommes. Elle me fait mal puisqu’elle en appelle à mes origines, ma condition d’Arabe, mon drame d’être femme et arabe. Elle me brûle. Ce film me brûle. Il détruit mes illusions les unes après les autres et les scènes défilent.
Elle sont trois, Fayza, Seba et Nelly, trois femmes de différents milieux dans une ville où les femmes n’existent pas, rasent les murs et se couvrent pour ne pas attirer les hommes, ne pas provoquer l’animal, ne pas être l’instrument du péché. Leurs histoires se croisent dans un ballet où elles sont les proies au quotidien de harcèlement, attouchement, agression des mâles en mal de sexe tout autour d’elles, comme autant de prédateurs maintenus en cage par un surplus de croyance et une limite de moyens. Car comme partout ailleurs dans le monde arabe, on ne couche pas facilement au Caire. C’est proscrit, c’est haram, ça coûte cher.
La blessure, la voilà !
Elles sont courageuses. Elles veulent changer les choses. Elles ont l’impression qu’elles peuvent se battre, elles essayent même et déclenchent tout un scandale. Mais ça ne suffit pas. C’est plus compliqué que ça, plus malin. C’est une blessure profonde et inscrite dans les gènes de nos sociétés gangrenées par le mépris autorisé du statut de femme et l’ignorance archaïque de la sexualité, la peur du sexe, la puissance du refoulement. Une blessure qui ne cicatrise pas.
Les femmes du bus 678 n’est pas un grand film comme on l’entend. Ce n’est pas un chef d’œuvre du 7ème art et il souffre même d’un excès de pathos, parfois maladroit, typique du cinéma égyptien. Mais c’est un film fort, poignant, nécessaire. Un message au delà de l’espoir pour dire qu’il n’y a pas d’espoir.
Mohamed Diab a réussi à signer un premier long-métrage sans leçon de morale, loin de tout manichéisme, où les coupables sont autant victimes que leurs victimes et le changement ne va pas de soi. Il a saisi la bourgeoise déprimée, l’artiste enragée, la voilée effrayée, toutes dans le même panier mais incapables de se solidariser. Il a même pointé celle qui aime bien, elle, se faire tripoter dans le bus. Et pour ça, il me rappelle cette phrase d’Orson Welles : “Je ne suis pas là pour donner la solution, je montre le problème”. Mohamed Diab a montré le problème, et il nous concerne tous. Et toutes.




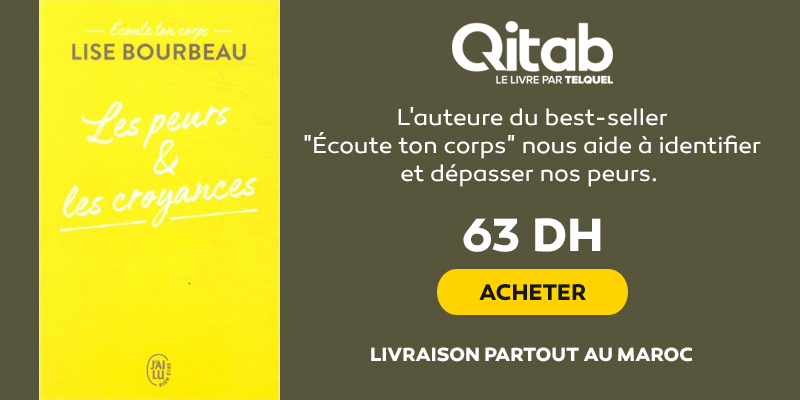
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous
Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer